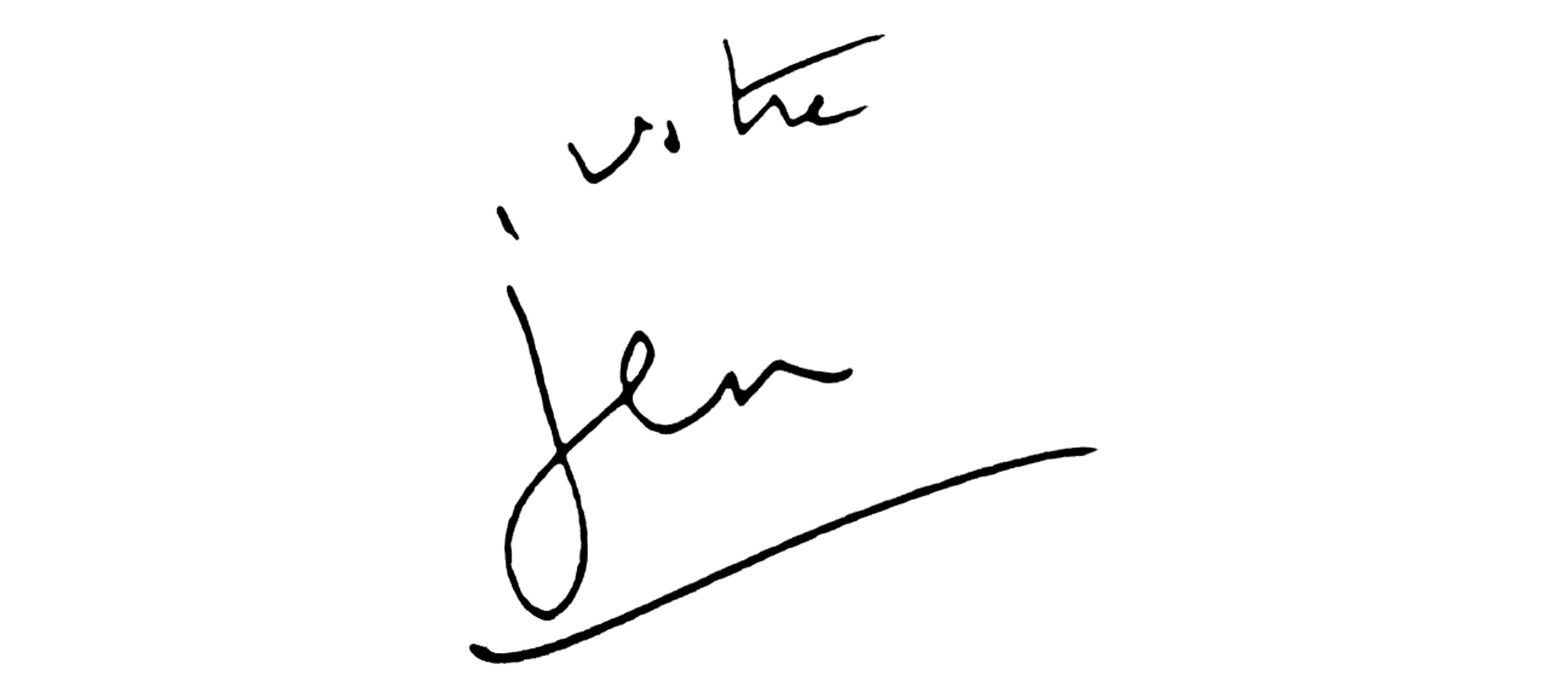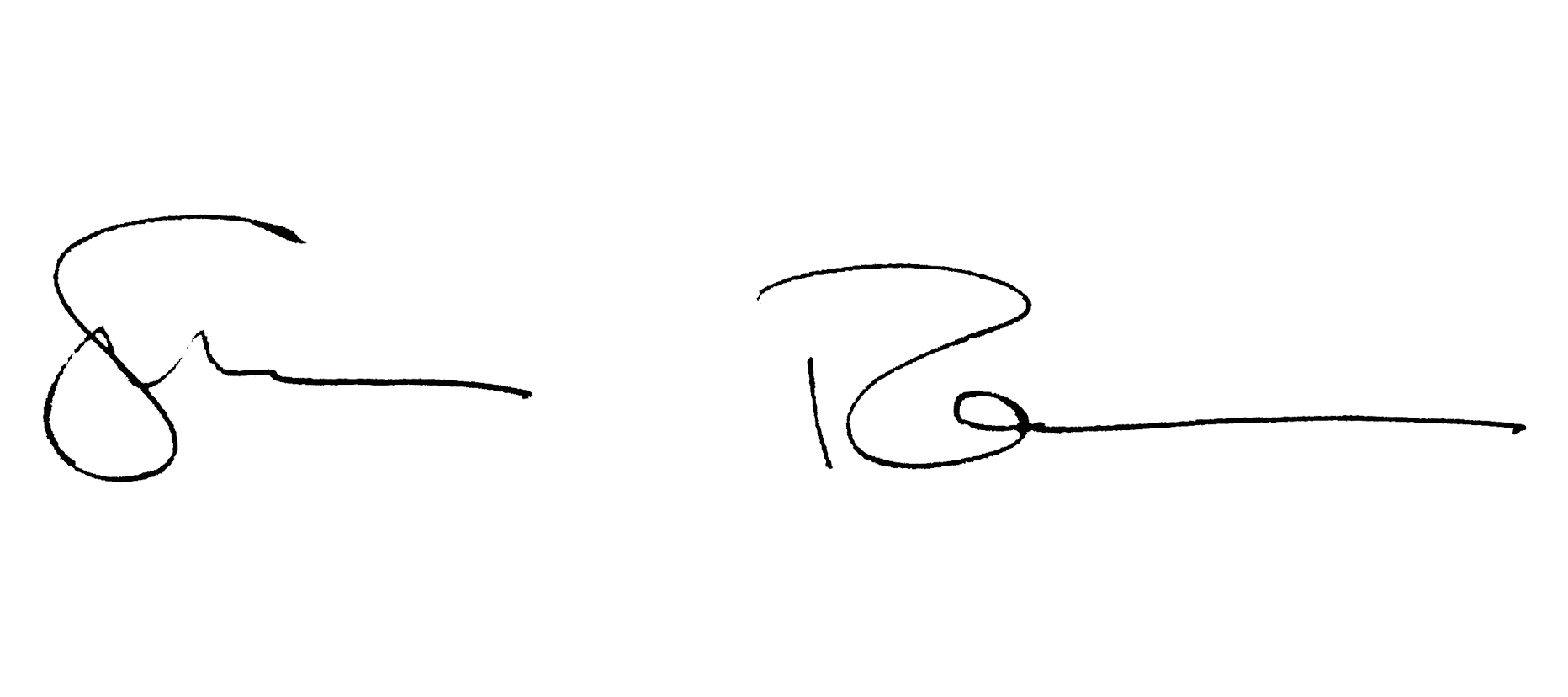October 31, 2021
Natalie Barney, une éternelle conquérante
Le mercredi 25 octobre 1963,à 17 heures, je suis entré chez Natalie Barney, au 20 rue Jacob, dans le sixième arrondissement de Paris. Depuis, je n’en suis plus sorti. Je demeure le bienheureux captif de Natalie qui, peu avant sa mort, le 2 février 1972, m’avait répété : <N’oubliez jamais que je serai toujours auprès de vous, en Amazone> et prédit : <La récréation ne sera jamais terminée entre nous>.
En 1963, j’avais vingt-huit ans et Natalie Barney en avait quatre vingt sept.
J’oubliais son âge. Elle oublia le mien. A la faveur de cet oubli naquit la spontanéité de nos rapports et s’ensuivit une harmonie dont la perfection semblait préétablie.
Je débutais comme journaliste, au Figaro Littéraire. Natalie était un monument légendaire. Elle avait inspiré à Remy de Gourmont ses Lettres à l’Amazone, à Liane de Pougy son Idylle saphique, à Renée Vivien ses meilleurs poèmes et à Romaine Brooks l’un de ses meilleurs portraits.
Natalie avait été aussi Flossie dans Claudine à Paris de Colette, Evangeline Musset dans L’Almanach des dames de Djuna Barnes, Laurette dans L’Ange et les pervers de Lucie Delarue-Mardrus, Valérie Seymour dans Le puits de solitude de Radclyffe Hall.
L’Amazone ne s’était pas contentée d’être une muse. Elle écrivait et avait publié en 1910 un recueil de pensées, Eparpillements, qui contient d’inoubliables aphorismes comme <La vie la plus belle est celle que l’on passe à se créer soi-même, non à procréer> ou <Comment vous vouloir du mal ? N’êtes-vous pas ce que j’aurais pu vous souhaiter de pire ?>.
Bref, Natalie était tout, je n’étais rien, et peut-être que mon néant la fascinait. Elle entreprit mon éducation, sans être rebutée par une telle tâche dont elle n’ignorait pas les difficultés. <Que l’éducation est longue à faire avec un jeune homme aussi indépendant que vous> soupirait-elle.
Natalie avait bien d’autres raisons de soupirer. Un an avant notre rencontre, elle avait alors 86 ans, elle avait fait la conquête d’une jeune femme de soixante ans qui avait abandonné son mari, sa fille et son petit-fils pour suivre l’Amazone. Cette jeune femme de soixante ans portait un grand nom, avait été dame d’honneur de l’une des dernières reines d’Europe Centrale et exécutait d’impeccables grandes révérences de cour que Natalie et moi applaudissions en riant tandis que, dans un coin, Romaine Brooks , se renfrognait de plus en plus.
Romaine, pendant toute son existence de peintre renommé, avait aimé l’Amazone et supporté tant bien que mal ses infidélités. Romaine espérait que, à la fin de leur vie commune, elle n’aurait plus à partager Natalie qui pourtant ne cessait d’affirmer : <en amour, je n’aime que les commencements>, et de mettre en pratique cette affirmation.
Cette sultane octogénaire espérait faire vivre en son harem, ses deux favorites, la plus ancienne et la nouvelle. La situation devint rapidement intenable. Sommée de choisir, l’Amazone donna la préférence à la nouvelle à qui elle révélait d’irrésistibles plaisirs que cette jeune femme de soixante ans ne soupçonnait même pas !
Natalie n’avait plus rien à apprendre à Romaine. Toutes deux se connaissaient par cœur. Romaine ne supporta pas cette ultime infidélité de sa Natalie qui, elle, en déduisit que Romaine ne l’aimait plus.
<Puisque Romaine ne m’aime plus, pourquoi continuerai-je à aimer Romaine ?> me confiait-elle, car elle m’avait pris pour confident.
Comme dans une tragédie de Racine, je jouais le rôle du confident. J’assistais à cette tragédie de Lesbos, en récitant du Racine que je retouchais quelque peu pour les besoins de la cause. Je disais à Natalie :
<Ce n’est plus une ardeur dans VOS veines cachée
C’est Vénus toute entière à sa proie attachée>.
Nous avions décidé de surnommer Vénus la jeune femme de soixante ans, une Vénus callipyge, excessivement fardée, mais possédant les plus beaux yeux bleus du monde, deux morceaux d’azur que l’on ne se lassait pas de contempler.
Quand je l’ai connue, Natalie Barney avait coutume de passer l’hiver sur la Côte d’Azur, et l’été en Suisse, terre natale de cette Venus qui y possédait un petit palais au bord d’un lac.
Le printemps et l’automne ramenaient Natalie à Paris et à nos déjeuners en tête-à-tête. Sa dernière conquête en profitait pour s’éclipser et inviter à déjeuner sa cousine Marthe Bibesco ou son ami, le peintre Edouard MacAvoy.
Natalie m’avait aisément converti à son culte du tête-à-tête et avait décrété que le mercredi serait notre jour puisque nous nous étions rencontrés un mercredi et que c’est également ce jour-là qu’elle rendait visite à Gourmont.
<Je vous attends mercredi, sans fleurs, ni couronnes, à la rencontre de nos mains> m’écrivait-elle pour me confirmer notre rendez-vous hebdomadaire, comme si j’étais capable d’oublier ce rendez-vous que j’attendais avec impatience et qui durait exactement de 13 à 16 heures, selon un rituel immuable.
Dans la salle à manger, face aux portraits de Natalie Barney et d’Elisabeth de Gramont par Romaine Brooks, portraits qui sont maintenant au musée Carnavalet, nous déjeunions rapidement et vers 14 heures, Natalie allait s’étendre sur le divan de son salon et je m’asseyais à ses pieds, ma tête reposant sur une tapisserie offerte par l’une des premières, et des plus remarquables, conquêtes de l’Amazone, Liane de Pougy.
<Liane, ah ma Liane, comment a-t-elle pu dire que j’étais son plus grand péché et rompre avec moi ?> me demandait-elle. Interrogation que je laissais sans réponse. Je parlais peu, préférant écouter l’Amazone égrener ses souvenirs amoureux. De temps en temps, elle s’interrompait pour me regarder attentivement et constater : <Comme vous êtes jeune et comme vos cheveux sont noirs>.Maintenant, je ne suis plus jeune et mes cheveux sont blancs.
Nous nous quittions avec le sentiment de ne nous être rien dit. <Oui, apprenez l’anglais, nous avons tant de choses à nous dire que deux langues n’y suffiront pas> me conseillait l’Amazone qui, bien que née en Amérique, parlait le français aussi bien que l’anglais, sans aucun accent.
Ce que Maurice Martin du Gard, le cousin de Roger, dans ses Mémoires, constate à propos de Gourmont : <Miss Natalie Clifford Barney, sur Remy de Gourmont, eut un pouvoir presque hypnotique> pourrait s’appliquer à ceux et à celles qui ont eu le privilège d’approcher l’Amazone : elle fascinait.
La fascination ne s’explique pas. Comment aurais-je pu y échapper quand cette inlassable sirène m’envoyait des messages grisants comme : <Non seulement, j’approuve tout ce que vous faites, mais aussi tout ce que vous ne faites pas> ou <J’ai devant moi vos roses ouvertes et notre amitié qui ne se fanera jamais>.
Natalie Barney ne se cachait pas d’appartenir à ce qu’elle appelait <le temps des équipages>. Je me demande si nous n’étions pas tous les deux, en plein
vingtième siècle, les derniers survivants de ce dix-neuvième siècle dont Natalie avait vécu la fin avec l’ardeur de sa jeunesse.
Natalie Barney ne vivait pas seulement dans le passé, mais savait envisager l’avenir. Elle savait aussi contempler le présent en remarquant que <les Américains se conduisent très mal au Vietnam> ou <Ce Picasso dont on parle tant en ce moment, c’est bien le petit protégé de Gertrude Stein ?>.
Au printemps 1965, Natalie Barney m’écrivait : <Romaine m’a cédé son auto Studebaker, ayant acquis une voiture plus maniable pour son chauffeur aux pieds trop lourds pour le changement de vitesse automatique de cette marque américaine. Je crois que c’est l’auto qu’il vous faut. Considérez donc la Studebaker comme votre fiancée>.
Ces fiançailles avec la Stubaker tournèrent court. Trois cinglants échecs au permis de conduire, je n’étais pas doué, m’en détournèrent irrémédiablement. Natalie changea aussitôt ce triple échec en victoire : j’aurais le plaisir de ne pas me confondre avec l’ immense troupeau des automobilistes.
Pendant les fêtes de la Toussaint de 1966, à la demande de l’Amazone saisie d’une frénésie de rangement , je rangeais, ou plutôt, j’essayais de ranger, les lettres qui, peu à peu, avait envahi sa chambre, débordant des tiroirs, des corbeilles et des coupes.
Les lettres de Liane de Pougy voisinaient avec celles de Renée Vivien qui jouxtaient celles de Colette. Comme je ne dissimulais pas mon intérêt pour ces dernières reconnaissables à leur légendaire papier bleu. Natalie me demanda de les lire, et je les lus, de la première à la dernière, de la première qui devait dater du temps de leur liaison vers 1900, <Ma Natalie, quel bonheur d’avoir vu une créature comme toi, parfaite des pieds à la tête. Willy te baise les mains et moi, tout le reste. Ta Colette> à l’une des dernières, datée de 1953, un an avant la mort de Colette, <Ma Natalie, puisque visiblement ma présence ne te suffit pas, dis-moi quel est ton plat préféré et je dirai à Pauline de te le faire, mais je t’en conjure, viens déjeuner avec ta vieille Colette>.
Pendant plus d’un demi-siècle, Natalie Barney et Colette n’ont pas cessé de veiller l’une sur l’autre, même, et surtout quand elles étaient séparées par la distance ou par une guerre. Les <où es-tu, ma chère âme ?> que lance Colette à Natalie ne restent jamais sans réponse. Elles savent, ces deux séductrices octogénaires qui continuent chastement à se séduire, qu’elles partagent une indestructible intimité .
Colette et Natalie, ou les douceurs de l’amitié, cela aurait pu être le sujet traité de nos jours, par un moderne émule de La Fontaine qui l’aurait intitulé : Les deux amies. Car l’amitié pour ces deux jeunes octogénaires était vitale, comme l’était pour Natalie son environnement du 20 rue Jacob dont Germaine Beaumont célébrait <la paix végétale >, avec raison, puisque deux jardins entouraient cette demeure dont l’apparence rappelait celle de ces folies que les grands seigneurs faisaient bâtir pour fuir la cour et y abriter leurs galanteries . L’un, bien pourvu d’arbres, vit passer sous ses ombrages Racine et La Champmeslé et plus récemment, Louis Malle l’utilisa comme décor de promenade pour Jeanne Moreau et Maurice Ronet dans son film, Le Feu follet. L’autre jardin, plus petit, plus secret, abrite le Temple à l’Amitié .
Ces deux jardins, comme deux sentinelles, encadraient cette demeure où rêgnait l’Amazone qui aimait recevoir dans son salon en se balançant sur son fauteuil à bascule : <Ce fauteuil à bascule, c’est tout ce que j’ai gardé de mon Amérique natale> me disait-elle.
L’Amérique n’a pas su garder cette descendante de Joshua Barney qui s’illustra pendant la guerre d’Indépendance et du juge Miller, l’un des signataires de l’acte d’achat de la Louisiane. Natalie Barney, dès sa jeunesse, choisit Paris pour y vivre, aimer, recevoir, écrire.
<Je me suis installée ici en 1910, aimait-elle me raconter, je fuyais Neuilly et ses hivers trop rigoureux. C’est Lucie Delarue-Mardrus qui m’avait signalé que ce pavillon était libre ou presque. J’ai du l’arracher à un antiquaire avec qui les propriétaires s’étaient déjà engagés. Il faut lutter pour aimer les choses. Et ma liaison avec le 20 rue Jacob s’est transformée en un durable mariage. En entrant ici, on m’a dit les planchers sont fragiles, ils datent du dix-huitième siècle, n’y donnez pas de bal>. Alors, j’ai donné des réunions plus littéraires. Je n’ai pas tenu salon, je n’ai eu que des tête-à-tête. Vous en avez la preuve avec ces livres>.
Natalie me désignait les deux tables gothiques chargées d’œuvres d’amis qui vinrent les déposer là comme sur un autel, et qui portaient les noms de Remy de Gourmont, Paul Valéry, Marcel Proust, Max Jacob, Tagore, Rilke, Drieu la Rochelle, Milosz, pour ne citer que ceux-là. On aurait pu se croire dans un musée fermé au public et seulement ouvert aux plus grands noms de la littérature ou de la musique puisque Wanda Landowska, Darius Milhaud, Honegger vinrent jouer sur ce piano qui trônait au milieu d’autres instruments de musique, mandolines, violons ou violes d’amour. Décor admiré à la fois par Paul Morand et François Mauriac. Ce dernier décréta : <Miss Barney est le PAPE DE LESBOS >.Papesse aurait été plus juste. Natalie n’aimait pas le genre masculin…
L’amour de la littérature et de la musique conserve une éternelle jeunesse à ses adorateurs, et aussi cet esprit d’incessante conquête A quatre vingt sept ans, Natalie Barney avait gardé intacts l’esprit et le cœur de sa trente-quatrième année. Avec Vénus que Philippe Jullian en déformant son illustre nom avait surnommé <la Hourvary>, elle connaissait ses dernières voluptés. Avec moi, elle pratiquait, encore une fois, les voluptés de l’amitié et les plaisirs de la transmission. Que d’enseignements m’aura prodigués l’Amazone à chacune de nos rencontres, et dans ses lettres (1) qui en étaient le prolongement. Elle répandait ses trésors de sagesse sur moi qui en avais le plus grand besoin .Elle élargissait mes connaissances , à tous les sens que peut avoir ce terme. C’est ainsi que je fis la connaissance de quelques unes de ses amies parmi lesquelles Florence Jay-Gould qui voulut rencontrer ce jeune homme dont s’était entichée Natalie Barney.
(1)Toujours vôtre d’amitié tendre,
lettres de Natalie Barney à Jean Chalon
(Fayard)
Jean Chalon
Author, Portrait of a Seductress and Dames de coeur et d’ailleurs
Natalie Barney entered the world in 1876 on October 31, a day that would come to symbolize a great deal about who she was and the dual nature that marked her life.
Most Americans now think of October’s last day as merely a time for Halloween festivities. But Victorian-era Americans knew the day by two antithetical names, both of which had a pagan source: Holy Evening and Witches’ Sabbath. One name was sacred, representing propriety and spiritual good; the other, more profane name, celebrated evil spirits and magic.
The Witches’ Sabbath originated nearly two millennia ago among ancient Druids, the Celtic priestly upper class. Druids worshipped nature, practiced magic, and believed that, on the last night of the Celtic year (our calendar’s October 31), the Lord of the Dead ordered the unliving back to life. To ward these spirits off, Druids nurtured huge fires through that night. Eventually the day became known as the Witches’ Sabbath, when witches, warlocks, ghosts, and other wicked creatures were thought to frolick before a massive bonfire while planning the coming year’s mischief. When dawn arrived, bringing the holy day and all its saints to light, they fled.
The Holy Evening emerged early in the Seventh Century, when Catholics began to informally honor saints at a yearly festival. Pope Gregory IV made the practice official in 835. Church policy required that important festivals of conquered tribes be replaced with Christian celebrations on the same date, so Gregory decreed November 1, the start of the New Year for the Celts, as the day to honor Catholic saints. Called in early times Allhallows or Hallowmas, the name eventually evolved to All Saints Day.
Natalie thought of herself a “double being” and delighted in having entered life through a warp papered on one side with the sacred and on the other with the profane. A devotee of astrology and numerology, she believed that this duality had its genesis in her birthdate. Later, in Paris, she would form a club of friends born on the same day. They named themselves “The Scorpions” after their shared astrological symbol, and for decades celebrated October 31 as a group.
Acceptance of her dual nature allowed Natalie to live as she chose, offering neither apology nor explanation. Those who didn’t approve were free to go elsewhere. Most didn’t.
Natalie was a foremother to every woman today who leads the life she has chosen with her own free will. "It seems to me," she once wrote her own mother, Alice, "that those who dare to rebel in every age are those who make life possible—it is the rebels who extend the boundary of right, little by little."
Only seventeen when she penned those words, Natalie couldn’t possibly have known that she herself would extend boundaries by expanding the notion of what a woman’s life can be: a duality that encompasses the whole.
Suzanne Rodriguez
Author, Wild Heart: A Life